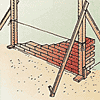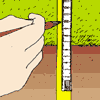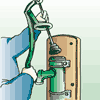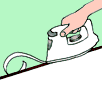|
COULER LE BETON:
Préparez le béton, à raison d'une part de ciment pour 2 parts de gros
sable et 3 de gravier. Procédez ensuite au coulage. Durant cette opération,
remuez le béton à l'aide d'un bâton, afin qu'il se répande bien dans
tout le volume du coffrage et sans former de trous.
| |
 |
|
LE
BETON
Le béton.r est composé :
' de liant ciment
' d'agrégats (sable et graviers)
' d'eau
|
 |
|
Utilisation
|
Béton maigre
(terrasse, blocs
|
Béton armé
(dalle de fondation)
|
Béton armé (linteau,
poteau)
|
|
Matériaux
|
|
Ciment
|
50 kg
|
50 kg
|
50 kg
|
|
Sable
|
80 kg
|
55 à 60 kg
|
60 à 65 kg
|
|
Gravier
|
160 kg
|
110 à 120 kg
|
95 à 100 kg
|
|
Eau
|
50 litres
|
60 litres
|
75 litres
|
|
Nature du mélange à
obtenir
|
peu mouillé
|
gras onctueux
|
gras assez liquide
|
|
 |
LE BETON ARME
Pour augmenter sa résistance, il faut armer le béton.
2 types d'armatures existent :
' les fers ronds en acier de diamètre de 6 à 32 mm.
Ils seront utilisés pour réaliser des poteaux, des
fondations.
' Le treillis soudé en fil d'acier.
Il est fourni en rouleau ou à plat.. |
 |
Il servira à armer une dalle ou une chape. Il pourra être
coupé aux dimensions pour une dalle intérieure |
 |
Avant de placer le treillis, on installera un isolant
(polystyrène) sur un lit de sable recouvert d'une
feuille de polyéthylène. Ces 2 éléments
contribueront à l'isolation (humidité + déperdition
calorique) de la chape. |
|
 |
|
Versez au sol, la quantité de sable sur une couche de 15 à 20 cm
d'épaisseur.
|
 |
 |
Versez, par
dessus, la quantité de liant : chaux ou ciment. |
Mélangez les 2 composants soigneusement à sec, en retournant des
pelletées entières, soit sur place, soit en constituant un
nouveau tas à côté. |
 |
 |
Une fois le mélange
obtenu bien homogène à sec, creusez un cratère d'un diamètre
de la moitié du tas conique réalisé. Versez-y de l'eau.
Reprendre dans la pelle, et projeter dans le bassin, des pelletées
successives de mélange sec, tout autour du tas. |
Rajoutez de l'eau jusqu'à ce que la masse semble humide,
retournez sur place jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Terminez en faisant des vague-lettes, si les marques restent,
votre mélange est mouillé correctement. Si elles s'écroulent,
le mélange est trop mouillé. |
 |
Si vous avez de grandes quantités de béton à préparer,
faites-le avec une bétonnière. Branchez l'alimentation électrique
à une prise avec terre. Le câble ne devra pas comporter de
blessures : n'oubliez pas que vous allez travailler en milieu
humide.
|
 |
 |
Versez l'eau nécessaire
au mélange (suivant les quantités des tableaux de mélanges aux
pages précédentes). Démarrez la rotation, remplissez ensuite la
cuve avec le sable. |
Incorporez la quantité de ciment par petite quantité, pour éviter
les amalgames. |
 |
 |
Ajoutez les
graviers, prévoyez une brouette pour recueillir le béton. La
cuve, à moins d'être utilisée de suite pour un deuxième mélange,
devra être nettoyée à l'intérieur et à l'extérieur, pour éviter
tout blocage de la roue dentée d'entraînement de la cuve. |
Vous pouvez louer une bétonnière. Les tarifs locatifs sont à
votre disposition au BricoService. |
 |
COMMANDE
DE BETON
Vous pouvez vous faire livrer du béton prémélangé. Afin
d'obtenir la quantité néces-saire à vos travaux, vous devez
communiquer les éléments suivants :
' la surface et l'épaisseur de la semelle à bétonner
' l'utilisation prévue pour cette dalle ( en pente, ')
' le jour et l'heure de livraison
' la modalité d'accès.
|
 |
 |
ACCES
ET DECHARGEMENT
Le camion bétonnière aura besoin, pour décharger, d'un accès
au lieu de coulage. Veillez à tenir compte des dimensions des
croquis, pour le passage du camion. La toupie ainsi nommée,
pourra livrer, grâce à des tuyaux démontables, le béton à
plusieurs mètres de l'arrière du véhicule. |
La partie à bétonner devra être dégagée et prête à l'usage.
Les coffrages et ferraillages réalisés. |
 |
.  |
SECURITE
Portez des gants de protection, le béton est abrasif. Un contact
prolongé sur la peau, aura, pour conséquences, l'apparition de
crevasses. Ne vous placez jamais derrière le camion dans une zone
cachée du rétroviseur, utilisé par le chauffeur pour le recul. |
|